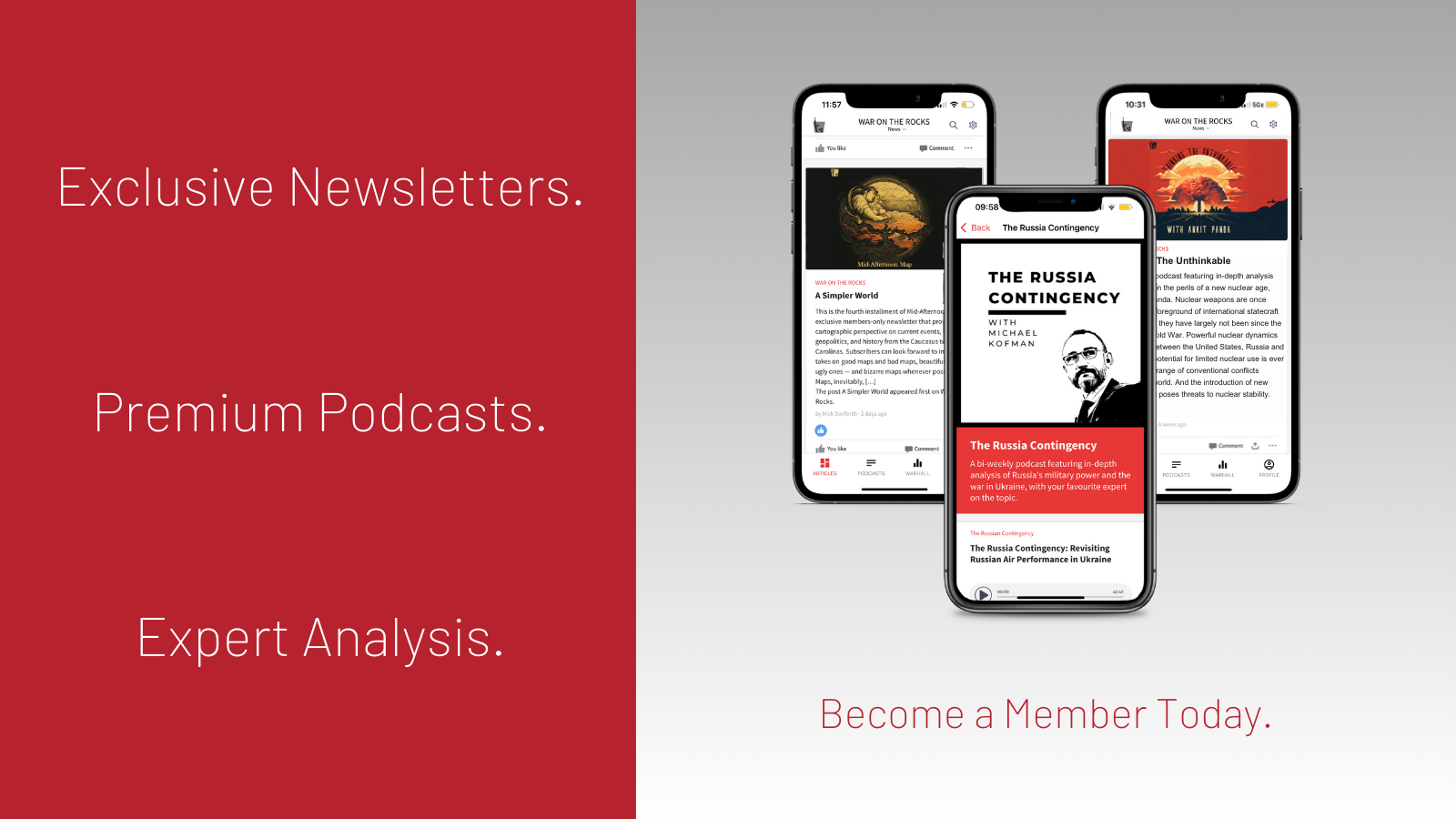Début novembre, après une rencontre avec le ministre chinois de la Défense, le secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth a renouvelé un rituel ancien dans les relations militaires entre Washington et Pékin : annoncer la mise en place de « canaux de communication militaires à militaires pour désamorcer et désescalader » les tensions. Pourtant, comme souvent avec ce genre de démarches, l’effet pratique reste incertain. La recherche de mécanismes efficaces de communication de crise entre les armées américaine et chinoise date des années Clinton ; pourtant, les progrès ont été lents et peu concluants, et Beijing utilise rarement ces liens en pleine crise.
Washington persiste néanmoins dans cette voie pour une raison simple. Lors de la guerre de Corée en 1950, l’absence de prise en compte des avertissements indirects chinois a conduit à des conséquences catastrophiques. À l’inverse, durant la Guerre froide face à l’URSS, les canaux de communication institutionnalisés ont joué un rôle crucial dans la prévention de l’escalade. Après la crise des missiles de Cuba, Washington et Moscou ont mis en place la célèbre « ligne directe » qui a été utilisée de nombreuses fois pour garantir la paix entre les deux puissances nucléaires. Ce succès a inspiré la création de lignes similaires entre d’autres États dotés de l’arme nucléaire, ainsi qu’entre pays sujets à des crises récurrentes.
En avril 1998, les responsables américains et chinois annonçaient la création d’une première ligne sécurisée de communication directe entre chefs d’État, pour permettre des échanges rapides, directs et francs en cas de besoin. Cette initiative faisait suite à la signature plus tôt dans l’année de l’accord militaire maritime consultatif. Au début des années 2000, les États-Unis proposaient la création d’une hotline pour la gestion des crises et le renforcement de la confiance. En 2008, un accord a permis d’établir une ligne téléphonique de défense rapide, étendue en 2015 pour inclure la visioconférence. Cette ligne constitue aussi un des outils du protocole bilatéral de 2014 sur la notification des « activités militaires majeures ». En 2016 enfin, une hotline a été mise en place sur les questions de cybercriminalité.
Cependant, au moment où les tensions bilatérales montent, ces mécanismes se révèlent rarement efficaces. Les responsables américains espéraient sans doute, s’appuyant sur l’expérience de la ligne directe États-Unis-URSS, que les messages transmis seraient perçus comme urgents et exigeraient une réponse rapide. Mais Pékin, manifestement, nourrit une vision différente.
Aux plus hauts niveaux, la communication rapide entre Washington et Pékin lors des crises fait défaut. Après le bombardement accidentel de l’ambassade chinoise à Belgrade en 1999, le dirigeant Jiang Zemin a refusé plusieurs jours de répondre aux appels du président Bill Clinton et suspendu les contacts militaires bilatéraux. En 2001, après la collision en vol entre un avion de reconnaissance américain EP-3 et un chasseur chinois J-8, le ministère chinois des Affaires étrangères a attendu 12 heures avant de répondre à l’ambassadeur américain à Pékin, sans utiliser la ligne téléphonique de défense. En 2022, lors de la visite controversée de Nancy Pelosi à Taïwan, les contacts directs entre hauts responsables militaires des deux pays ont également échoué. En février 2023, Pékin a rejeté un appel du secrétaire à la Défense américain Lloyd Austin via la ligne de défense après que la marine américaine ait abattu un ballon espion chinois, malgré le fait que cette hotline ait été précisément conçue pour gérer ce type de crise. Ces nombreux blocages contrastent avec une rare utilisation réussie de cette ligne en 2020, quand le général Mark Milley a pu rassurer son homologue chinois que le président Trump ne préparait pas une « surprise d’octobre » pré-électorale.
En règle générale, face aux crises, la Chine coupe les communications et suspend souvent les accords bilatéraux de contact militaire. Néanmoins, à l’issue des tensions, Pékin renouvelle presque systématiquement les négociations sur les mécanismes de communication de crise et la remise en marche des relations militaires, comme ce fut le cas après la confrontation du détroit de Taïwan en 1996 qui a conduit à l’établissement de la ligne présidentielle en 1998.
Ces négociations sont toujours ardues. Par exemple, les pourparlers pour la ligne téléphonique de défense ont duré plusieurs années, ne débouchant qu’en 2008, après une série d’incidents dont le test antisatellite chinois de 2007 et le refus de Pékin d’autoriser des escales de navires américains à Hong Kong la même année. Parfois, Pékin se montre plus ouvert : en 2014, à la suite d’une montée des tensions liée à des accusations américaines d’espionnage informatique par l’Armée populaire de libération, Washington et Pékin ont signé deux accords non contraignants pour réduire les risques militaires, notamment un accord de notification des activités militaires majeures et un mémorandum sur les règles de conduite. En 2020, ils ont également créé un groupe de travail sur la communication de crise, malgré un contexte diplomatique tendu lié à la pandémie de COVID-19, à l’expulsion de journalistes et à la fermeture du consulat chinois à Houston.
Ces observations amènent à réviser les attentes américaines vis-à-vis de l’usage que ferait la Chine de ces mécanismes. Pékin semble considérer la négociation de ces systèmes comme un exercice diplomatique utile pour restaurer la confiance et les liens militaires, mais demeure sceptique quant à leur utilité en cas de crise réelle. Pour les dirigeants chinois, les lignes directes et outils de gestion de crise ne sont pas des instruments de désescalade, mais plutôt des « ceintures de sécurité pour chauffards » qui légitiment et encouragent les actions militaires américaines qu’ils cherchent à contenir, notamment les opérations près de la Chine.
Sur le plan stratégique, les experts militaires chinois voient les communications de crise moins comme des outils pour éviter l’escalade que comme des contraintes potentielles à leurs ambitions d’exploitation des situations de crise à des fins géopolitiques. Depuis plus de vingt-cinq ans, la Chine a développé une doctrine de « contrôle de l’escalade » qui vise à maîtriser et exploiter les crises, y compris par des tactiques d’escalade calculée, pour consolider sa position stratégique interne et internationale.
Par ailleurs, les perceptions américaines et chinoises de ce qu’est une crise diffèrent fondamentalement. Par exemple, en 2020, lors de l’incertitude liée aux élections américaines, Pékin semblait ouvert à la communication rapide visant à dissiper les malentendus. En revanche, en 2023, lors de l’incident du ballon espion, le ministre chinois de la Défense a refusé l’appel de son homologue américain, estimant que Washington « n’avait pas créé l’atmosphère adéquate » pour un dialogue constructif.
Cette réticence chinoise est aussi liée à des asymétries militaires perçues. Selon Hu Bo de l’université de Pékin, contrairement à la situation États-Unis-URSS où un équilibre militaire existait, le rapport de forces inégal entre Washington et Pékin fragilise la crédibilité de la dissuasion mutuelle et limite la capacité de la Chine à négocier et appliquer des mécanismes de gestion des crises. De plus, sur le plan nucléaire, Wu Riqiang de l’université Tsinghua souligne que la Chine privilégie le développement de sa capacité de représailles plutôt que des démarches de contrôle des risques ou de transparence, en refusant de suivre les principes occidentaux de maîtrise des armements.
Les différences organisationnelles jouent également un rôle. Aux États-Unis, plusieurs niveaux de commandement sont habilités à prendre des décisions en temps réel, facilitant la communication rapide. En revanche, le système chinois est très hiérarchisé et conçu pour une circulation descendante de l’information, demeurant largement sous contrôle des plus hauts dirigeants. Les échanges directs entre fonctionnaires chinois et étrangers sont aussi très limités, afin d’éviter toute accusation d’influence étrangère. Il en résulte un délai conséquent avant qu’une réponse ne soit décidée au plus haut niveau.
Enfin, Pékin considère les mécanismes de communication de crise comme secondaires par rapport à la quête d’une stabilité globale des relations, fondée sur la reconnaissance par Washington de la légitimité du régime chinois et le respect des « intérêts fondamentaux » de la Chine.
Pour les États-Unis, il est donc temps d’abandonner l’idée que ces mécanismes bilatéraux garantiront un moyen fiable d’éviter l’escalade en crises. Cela ne signifie pas renoncer à ces initiatives qui restent utiles pour les échanges militaires et diplomatiques hors crise. Mais les décideurs doivent comprendre que Pékin ne cherche pas véritablement à institutionnaliser des communications rapides en situation de tension. Par exemple, durant la visite de Nancy Pelosi à Taïwan, des responsables américains ont décrit la situation comme « deux trains lancés vers une collision », chaque camp agissant en toute légitimité selon lui, cherchant seulement à gérer la crise plutôt qu’à l’éviter.
Cette réalité oblige à adopter un objectif plus modeste : ralentir autant que possible ces « trains » pour réduire l’incertitude et le risque d’escalade via des efforts pragmatiques. Il s’agit de consolider des canaux de communication moins vulnérables aux suspensions lors des crises politiques et militaires, en intégrant à la fois des mécanismes gouvernementaux et extragouvernementaux.
Sur le plan gouvernemental, un enseignement des tensions des années 1950 est pertinent : malgré des menaces nucléaires directes américaines envers la Chine, Washington et Pékin ont maintenu des discussions régulières secrètes jusqu’en 1971. Ces échanges, parfois houleux, ont permis de réduire le risque de conflit. Des rencontres à bas bruit entre officiels désignés pourraient remplir un rôle similaire aujourd’hui.
Une autre proposition serait d’instaurer un coordinateur non politique rattaché au Conseil de sécurité nationale américain, chargé de la relation avec la Chine. Ce poste unique, indépendant des changements politiques, pourrait faciliter la continuité des contacts et la gestion en temps réel lors des crises, en compensant les fluctuations du personnel de part et d’autre.
Parallèlement, les échanges de « Track 2 » — dialogues non officiels et extra-gouvernementaux — sont reconnus par les experts américains et chinois comme des forums essentiels dans les moments de forte tension. Par exemple, la réussite américaine en 2020 pour dissiper l’« October surprise » a largement bénéficié de ces canaux informels qui transmettaient les préoccupations chinoises. Des initiatives comme l’« U.S.-China Military-to-Military Initiative », regroupant retraités de haut rang des deux armées, offrent de précieux espaces de dialogue. Cependant, la disparition progressive d’instituts financés par le Congrès américain, tels que le Wilson Center et l’Institute of Peace, nuit à cette approche.
Sur le plan technique, l’expert en gestion des risques Christian Ruhl propose la création d’une hotline textuelle, plus sécurisée, facile à protéger en cas de conflit et adaptée aux contraintes politiques et militaires chinoises, qui limitent la communication en temps réel entre fonctionnaires. Historiquement, la première hotline États-Unis-URSS fonctionnait par télégraphie, garantissant un temps de réflexion avant réponse. Ce système permettrait aussi une confirmation de réception sans engagement immédiat, accélérant ainsi les échanges tout en évitant un « oui » formel d’un faible niveau de responsabilité.
Certains estiment qu’une crise majeure à la manière de celle des missiles de Cuba serait nécessaire pour instaurer des mécanismes de communication aussi robustes que ceux développés entre Washington et Moscou. Pourtant, alors que la rivalité américano-chinoise s’intensifie sur tous les fronts militaires, que les contacts diplomatiques s’enlisent et que l’idée d’un conflit inévitable s’installe, attendre qu’une crise impose la coopération serait un pari dangereux que ni Pékin ni Washington ne peuvent se permettre.
Carla P. Freeman est directrice de l’Institute of Foreign Policy de la Johns Hopkins School of Advanced International Studies et chargée de cours en affaires internationales. Elle a travaillé comme experte senior pour l’équipe Chine de l’US Institute of Peace. Alison McFarland est doctorante en sciences politiques à Princeton, spécialisée dans la politique étrangère chinoise et les études sur les conflits, ayant également travaillé à l’US Institute of Peace.