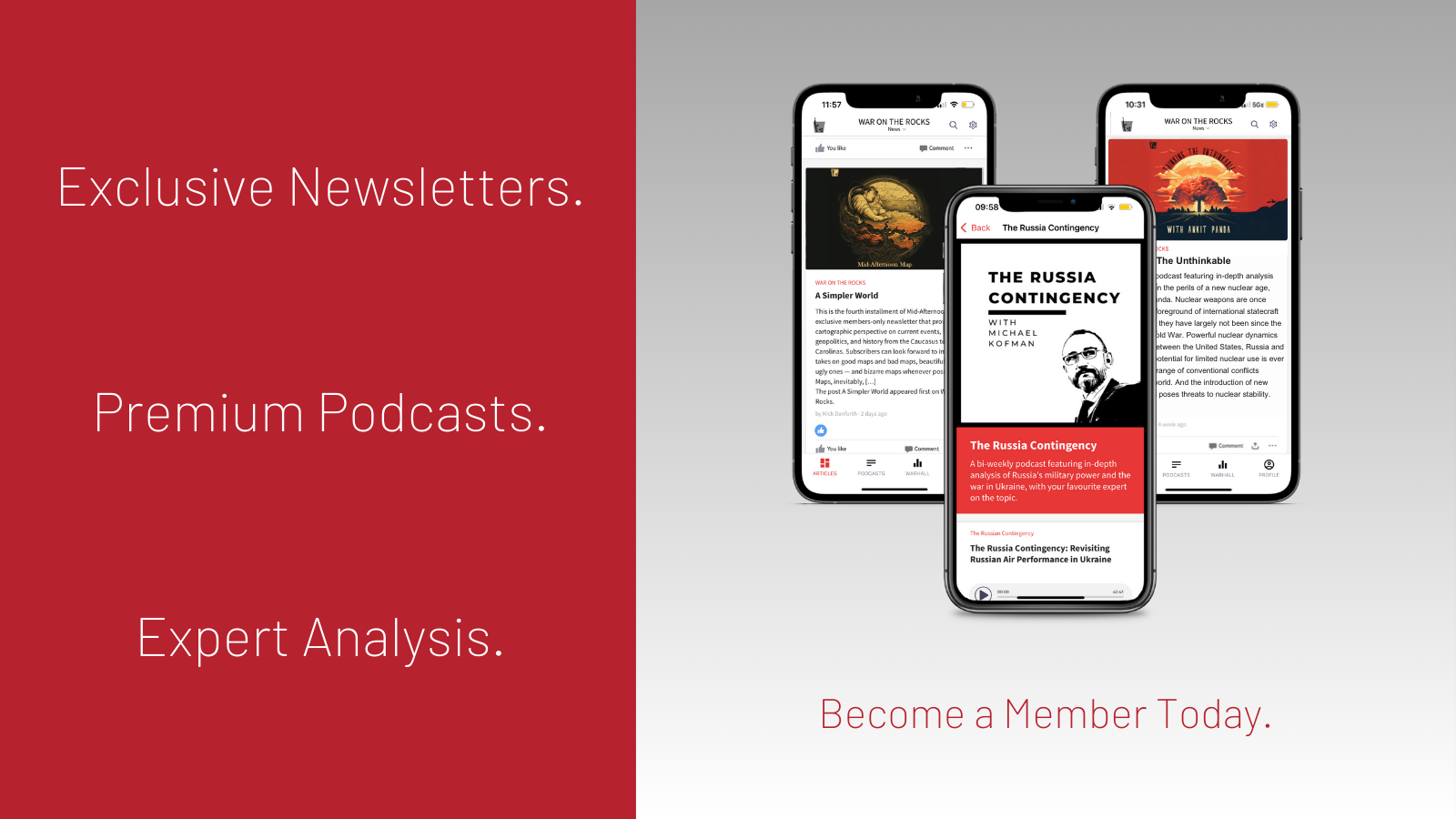Le 5 décembre 2025, le chancelier allemand Friedrich Merz a franchi une étape majeure dans son projet de bâtir la « plus forte armée conventionnelle d’Europe » : le parlement allemand a adopté une loi controversée obligeant tous les hommes allemands à s’enregistrer pour un service militaire éventuel, ce qui pourrait constituer une première étape vers la réintroduction de la conscription si les recrutements volontaires ne suffisent pas. Ce succès est survenu après plusieurs semaines de négociations tendues au sein de la coalition au pouvoir, marquées par des accusations mutuelles de « sabotage ». Finalement, Merz est parvenu à maintenir l’unité de sa coalition, la loi étant approuvée par 323 voix contre 272.
Ce vote difficile contraste nettement avec l’élan dont bénéficiait Merz trois mois plus tôt. En août, il avait réuni l’ensemble de son cabinet au ministère de la Défense, une première depuis près de vingt ans. Aux côtés du général américain Alexus Grynkewich, commandant suprême allié en Europe (SACEUR) de l’OTAN, Merz annonçait que l’Allemagne était prête à assumer un rôle de leadership plus actif en matière de sécurité européenne. Le cabinet adoptait alors un projet de loi sur le service militaire et créait un nouveau Conseil national de sécurité, s’appuyant sur une récente réforme constitutionnelle autorisant des investissements majeurs dans la défense. Pour un temps, Merz semblait incarner la « Zeitenwende », ce tournant historique proclamé après l’invasion russe de l’Ukraine.
La controverse autour de la reprise de la conscription est un rappel à la réalité. La disposition de la population à défendre l’Allemagne en temps de guerre s’accroît, mais reste relativement faible, tandis que des doutes subsistent quant à la capacité de la Bundeswehr à atteindre les ambitions gouvernementales après des décennies de sous-investissement. Cependant, les progrès réalisés dans la réforme du service militaire témoignent d’une volonté politique plus forte qu’auparavant, montrant que des avancées graduelles peuvent conduire à des réformes significatives.
Le défi de Merz reflète les dynamiques complexes qui ont façonné la politique de sécurité allemande depuis 1945. La montée des menaces et les attentes des alliés poussent l’Allemagne à adopter une posture de défense plus active, tandis qu’une culture profondément enracinée de retenue continue d’influencer les opinions publiques. Ces tensions expliquent pourquoi la « Zeitenwende » progresse de manière inégale, avec des avancées souvent suivies de reculs.
Les États-Unis et les alliés européens de l’Allemagne doivent ajuster leurs attentes en conséquence. Cette transformation est graduelle et non instantanée. Pour Merz, le véritable enjeu ne réside pas seulement dans l’adoption d’une loi sur le service militaire ou la réalisation d’objectifs budgétaires, mais dans la transformation de la culture stratégique allemande – ces schémas durables de pensée qui guident une nation dans sa conception et son emploi de la force. Une telle mutation ne peut s’opérer du jour au lendemain, mais le temps est un facteur-clé si l’Allemagne veut éviter d’être marginalisée dans un environnement géopolitique qui évolue rapidement. Si elle réussi, l’Allemagne pourrait achever son long cheminement, passant d’un pays qui associe le pouvoir à la culpabilité à un État qui le conçoit comme une responsabilité.
Le paradoxe allemand d’après-guerre
Sortie des ruines de la Seconde Guerre mondiale, l’Allemagne de l’Ouest devait jongler avec une situation délicate. Face à la menace soviétique, elle subissait des pressions croissantes pour reconstruire une armée capable de dissuader toute invasion soviétique en Europe occidentale, tout en rassurant ses voisins sur le fait qu’elle ne compromettrait plus la paix européenne.
Comme l’exprima un jour Lord Hastings Lionel Ismay, premier secrétaire général de l’OTAN, l’objectif initial de l’alliance était de « garder les Soviétiques à l’extérieur, les Américains à l’intérieur, et les Allemands à plat ». L’adhésion de l’Allemagne de l’Ouest à l’OTAN et la création de la Bundeswehr en 1955 incarnèrent ce compromis : le pays pouvait se réarmer, mais sous contrôle allié. Il ne développerait pas d’armes nucléaires, mais hébergerait des armes américaines dans le cadre du partage nucléaire de l’OTAN.
La prudence allemande vis-à-vis de la puissance militaire résultait non seulement des contraintes alliées mais aussi du travail de mémoire sur les crimes nazis. Cette histoire donna naissance à une culture de retenue (Kultur der Zurückhaltung) – une identité nationale fondée sur le repentir et la conviction que l’autolimitation, notamment dans l’usage de la force militaire, était indispensable. Des spécialistes comme Colin Gray, Elizabeth Kier ou John Duffield ont montré que la culture stratégique reflète les façons historiquement conditionnées de penser la sécurité et l’utilisation de la force.
Pour l’Allemagne, cette retenue est devenue un état d’esprit durable influençant tant les élites que l’opinion publique dans leur conception du rôle du pays dans le monde. En parallèle, les dirigeants politiques s’en sont parfois servis comme d’un prétexte pour refuser les demandes alliées, retarder les investissements militaires et gérer des coalitions gouvernementales, même si Berlin restait au cœur de l’intégration économique européenne. Ainsi, la culture stratégique allemande est à la fois enracinée dans l’histoire et occasionnellement instrumentalisée politiquement.
Durant la Guerre froide, cette dynamique engendra un équilibre stable mais fragile. L’Allemagne de l’Ouest construisit l’une des armées les plus performantes de l’OTAN, avec plus de 500 000 soldats actifs au summum de sa force, consacrant entre 2,5 et 3 % du PIB à la défense dans les années 1980. Pourtant, elle n’engagea pas ses forces à l’étranger. La puissance militaire était acceptée comme une nécessité, non comme un instrument de politique étrangère – une tension qui marquera longtemps la politique de sécurité allemande, même après la chute du mur de Berlin.
De la « puissance civile » à la complaisance
La fin de la Guerre froide a levé les pressions externes qui avaient équilibré la culture de retenue allemande. La disparition de la menace soviétique et la diminution des obligations OTAN conduisirent les dépenses de défense à chuter à environ 1,3 % du PIB en 2001, niveau qu’elles conserveront jusqu’en 2022. Ce phénomène est connu sous le nom de dividende de la paix.
L’Allemagne accepta un rôle de « puissance civile », privilégiant l’influence économique, diplomatique et multilatérale plutôt que la force militaire. Elle déploya des troupes dans les Balkans dans les années 1990 puis en Afghanistan après 2001, mais ces missions furent présentées comme humanitaires ou en appui à des alliances, s’inscrivant dans son identité civile.
Cette image façonna aussi le mandat de la chancelière Angela Merkel (2005-2021), qui chercha à modérer la Russie et la Chine par l’interdépendance économique – stratégie critiquée pour avoir accordé la priorité aux intérêts commerciaux à court terme au détriment de la sécurité à long terme. En 2011, son gouvernement suspendit la conscription, motivé par le constat que l’absence d’une menace militaire immédiate imposait de ne plus justifier un service obligatoire. L’Allemagne devint très dépendante du gaz russe bon marché, supposant qu’un conflit majeur en Europe était désormais inimaginable malgré l’annexion de la Crimée par Moscou en 2014.
La Zeitenwende de Scholz
Cette illusion fut balayée par l’invasion russe de l’Ukraine en février 2022. En quelques jours, le chancelier Olaf Scholz déclara une « Zeitenwende » et s’engagea à restaurer la capacité militaire allemande. Son gouvernement lança un fonds spécial de 100 milliards d’euros pour moderniser la Bundeswehr et s’engagea à respecter les objectifs de dépenses militaires de l’OTAN.
La politique de Scholz marquait un tournant clair vers la dissuasion et la réduction des risques, cherchant à sécuriser et diversifier les chaînes d’approvisionnement pour limiter la vulnérabilité face à la « weaponisation » économique de la part de puissances autoritaires. Il diminua rapidement la dépendance allemande au gaz russe et supervisa l’adoption de la première stratégie nationale de sécurité et d’une stratégie chinoise en 2023, insistant sur la nécessité de se prémunir contre la coercition tout en maintenant une coopération quand possible.
Le budget de la défense atteignit 2 % du PIB en 2024, un niveau inédit depuis plus de trente ans, et l’Allemagne devint le deuxième plus grand donateur militaire à l’Ukraine après les États-Unis. Malgré ce changement de perception sécuritaire, la culture de retenue demeura forte, notamment au sein du parti de Scholz et de la société allemande. Le rythme des réformes ralentit, le recrutement stagna, et les objectifs de préparation opérationnelle furent compromis. Le gouvernement initiateur des changements s’effondra à la fin de 2024.
Merz : nouvelles ambitions, obstacles anciens
À son arrivée au pouvoir en mai 2025, Merz héritait d’une Bundeswehr seulement partiellement opérationnelle, sous forte pression américaine pour accroître les dépenses de défense face à une Russie de plus en plus audacieuse. Il fit le serment de restaurer la capacité militaire et de constituer la plus puissante force conventionnelle européenne.
Avant sa prise de fonction, Merz avait obtenu de justesse l’autorisation parlementaire de suspendre le « frein à l’endettement » constitutionnel, permettant des dépenses militaires dépassant 1 % du PIB, et de créer un fonds de 500 milliards d’euros pour la défense et les infrastructures. Ces mesures devraient mobiliser environ un billion d’euros d’investissements industriels et militaires lors de la prochaine décennie. Merz promet également d’atteindre les 5 % du PIB consacrés à la défense d’ici 2035, répartis entre 3,5 % pour les capacités militaires et 1,5 % pour l’infrastructure, l’industrie et la résilience.
Augmenter les effectifs et améliorer la préparation s’avèrent cependant extrêmement difficiles. Les manques dans des capacités clés – notamment la défense aérienne et les communications numériques – limitent la disponibilité générale. La Bundeswehr compte actuellement quelque 180 000 militaires actifs. Atteindre les objectifs OTAN implique d’avoir environ 260 000 militaires actifs et 200 000 réservistes d’ici 2035, soit 460 000 personnels au total. Or, Berlin n’a autorisé qu’une hausse de 1 750 soldats pour 2026, un rythme condamnant la réalisation des cibles à plusieurs décennies.
Le nouveau projet de loi instaure un système de service sélectif : tous les jeunes hommes de 18 ans rempliront un questionnaire et subiront un examen médical pour évaluer leur volonté et aptitude, tandis que les femmes pourront s’engager volontairement. La procédure commencera le 1er janvier 2026 pour les hommes nés en 2008 ou après. Le texte prévoit aussi une amélioration des rémunérations et avantages, ainsi que des incitations à prolonger le service. Initialement centré sur le volontariat, le cadre légal laisse toutefois la porte ouverte à la remise en place de la conscription obligatoire si les candidatures ne suffisent pas. La réussite du volontariat reste toutefois très incertaine.
Au-delà des obstacles juridiques et logistiques, se pose un défi culturel majeur. Bien que la majorité des Allemands reconnaisse la menace russe, leur disposition à lutter demeure limitée. Une enquête récente révèle que seulement 16 % des sondés seraient « certainement » prêts à combattre pour défendre le pays, et 22 % le feraient « probablement » – soit 38 %. Un large sondage mené par le Centre d’histoire militaire et des sciences sociales de la Bundeswehr montre des résultats similaires, avec 54 % des hommes et 21 % des femmes âgés de 16 à 49 ans prêts à prendre les armes en cas d’attaque, mais une moindre volonté parmi les jeunes hommes. La réforme du service militaire a suscité des protestations lycéennes et son succès dépendra de la capacité à convaincre directement les jeunes concernés.
Malgré des engagements financiers sans précédent, la capacité allemande à atteindre les forces envisagées pour les années 2030 reste incertaine. La réticence du public ne constitue pas le seul frein : une opposition existe aussi au sein des élites politiques et de la bureaucratie de la défense, qui tendent parfois à rejeter la faute sur la société, évitant ainsi de questionner leur propre lenteur à moderniser les institutions. Parallèlement, les avancées les plus significatives viennent sans doute du secteur privé. Rheinmetall, par exemple, a augmenté sa production de munitions à un rythme record, tandis que d’autres entreprises intensifient la fabrication de missiles et de radars, et que des startups d’intelligence artificielle spécialisées en défense émergent, témoignant d’une montée en puissance industrielle qui précède celle de la culture stratégique.
Les perspectives
Depuis huit décennies, contraintes extérieures et retenue intérieure ont marqué la politique étrangère allemande. Pendant la Guerre froide, la menace soviétique et les exigences de l’OTAN tempéraient la culture de puissance limitée. Après 1990, avec la réduction du sentiment de menace, la retenue est devenue un principe dominant. Depuis l’agression russe en Ukraine, la pression extérieure pousse à plus d’affirmation, même si la culture stratégique continue de guider le rythme et la nature des changements. La « Zeitenwende » incarne donc une évolution progressive plutôt qu’une révolution.
Le débat sur la conscription illustre parfaitement cette tension : un gouvernement sous pression pour jouer un rôle sécuritaire plus important, mais toujours freiné par une culture stratégique qui perçoit l’usage de la force comme un danger pour la stabilité plutôt que son garant. Pour dépasser cette contradiction, le gouvernement doit clarifier au public le rôle des capacités militaires dans la sécurité européenne et l’intérêt des jeunes générations à s’investir dans la défense nationale. Ce débat sur la conscription s’inscrit ainsi dans une dynamique politique plus large, montrant que même des réformes progressives peuvent profondément influer sur la place de l’Allemagne dans l’architecture sécuritaire européenne.
Cependant, cette approche graduelle comporte des risques. La transformation allemande s’opère dans un contexte stratégique qui ne dépend plus uniquement de Berlin, et sa cadence modérée ne rassure pas pleinement le flanc oriental de l’OTAN, qui attend des résultats immédiats. Alors que l’Allemagne discute de ses réformes, la Pologne et d’autres alliés de l’Est émergent comme de nouveaux centres de gravité en Europe. Le pays dispose donc d’une fenêtre étroite pour combler ses lacunes s’il souhaite demeurer un pilier central de la sécurité européenne et réduire sa dépendance aux États-Unis.
Pour Washington, la question clé n’est pas tant de savoir si l’Allemagne change, mais ce qu’elle sera capable de fournir, et dans quel délai. La récente proposition de l’ambassadeur américain auprès de l’OTAN, Matt Whitaker, selon laquelle l’Allemagne pourrait un jour assumer la fonction de commandant suprême allié en Europe – un poste toujours occupé par un Américain depuis Eisenhower en 1950 – illustre l’ampleur de l’évolution des attentes.
Les États-Unis devraient continuer à encourager Berlin à accroître ses responsabilités, tout en restant prudents quant à une expansion rapide des forces et lucides sur la possibilité qu’une Allemagne plus capable agisse de manière plus indépendante. La contribution la plus déterminante à court terme de l’Allemagne proviendra sans doute de son industrie de défense, dont la croissance dépasse celle de sa culture stratégique. Le renforcement de la coopération américano-allemande sur les questions industrielles de défense – illustré par des partenariats récents autour de drones, de systèmes de défense maritime et aérienne – sera crucial pour maintenir la dynamique. Le défi majeur reste de savoir si l’Allemagne réussira sa transformation stratégique avant que le temps ne presse.
Michael F. Harsch, Ph.D., est professeur associé à l’Eisenhower School de la National Defense University, spécialisé en sécurité internationale. Il est titulaire d’un doctorat en sciences politiques de la Free University de Berlin et a été chercheur invité à Harvard et Stanford.