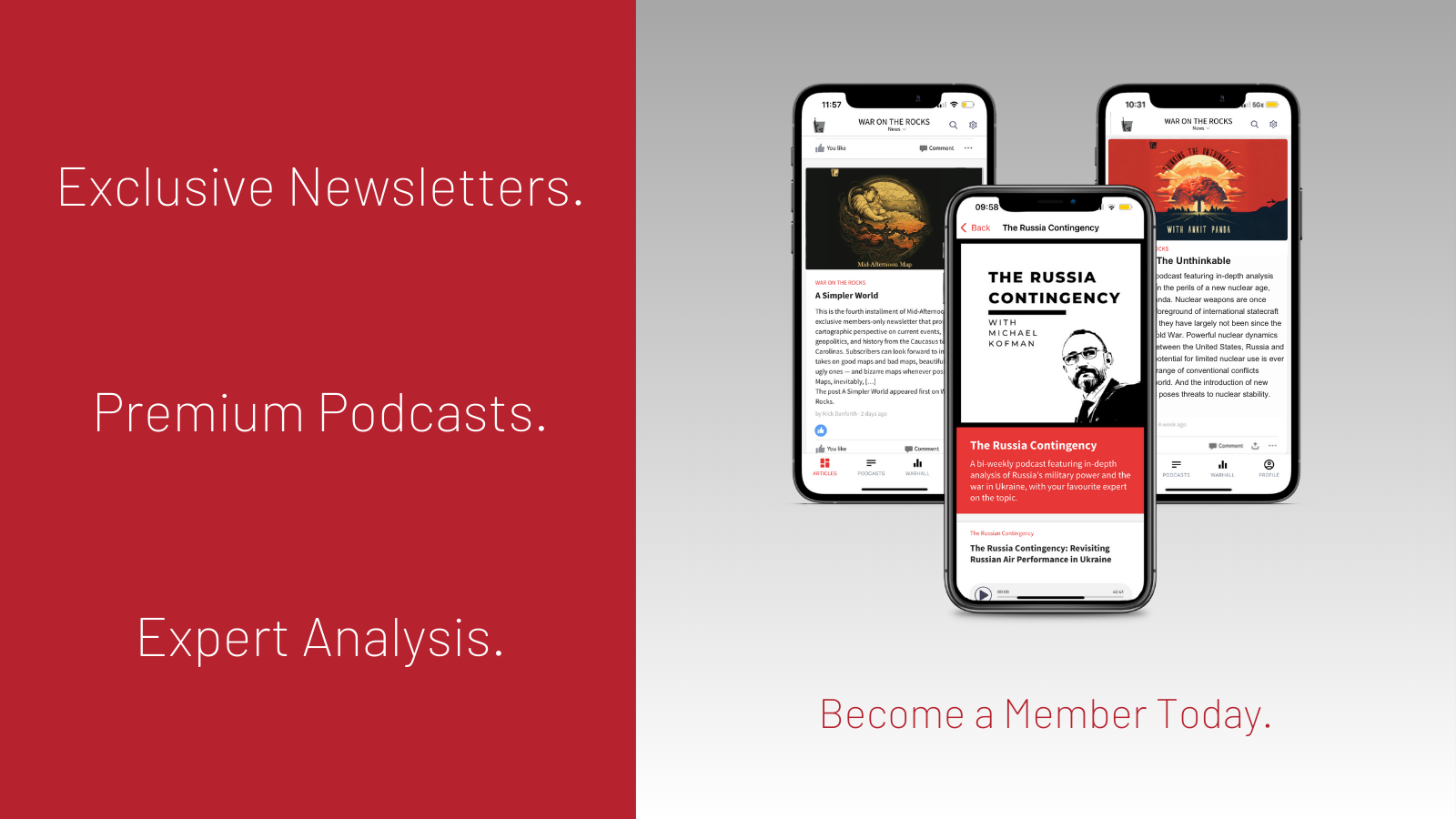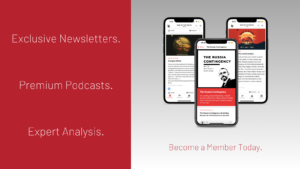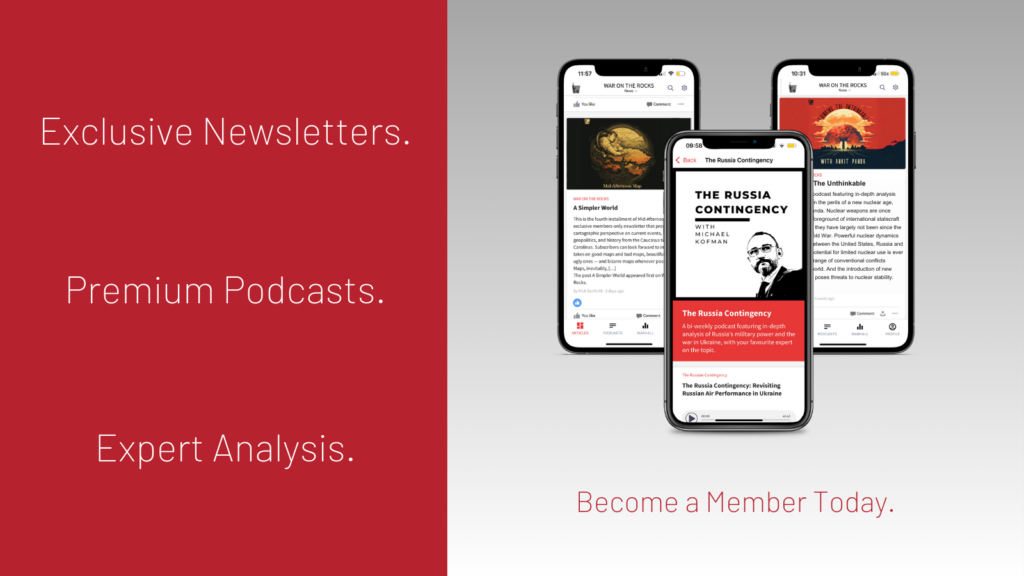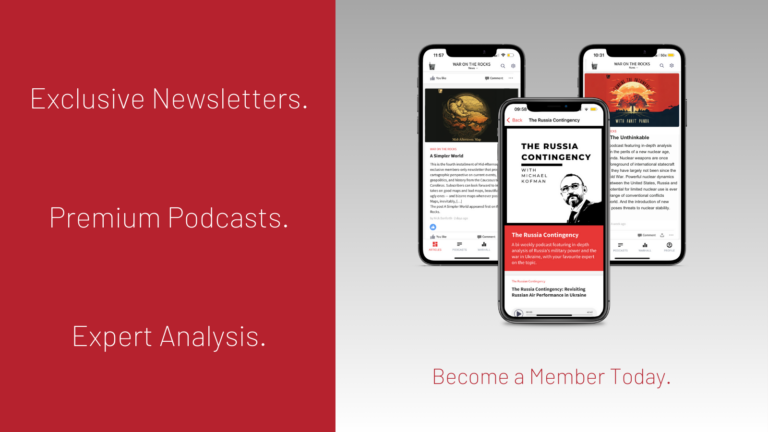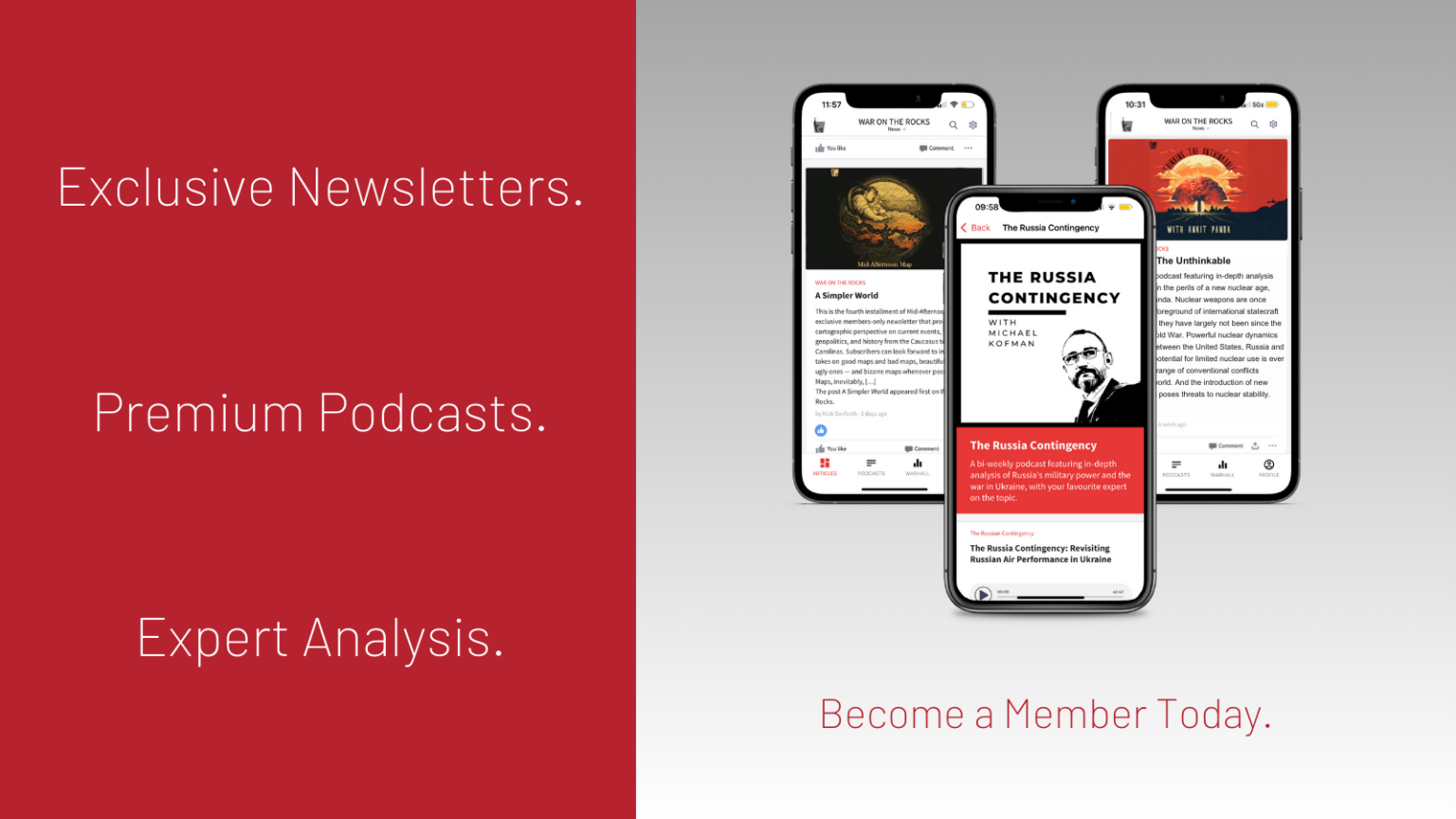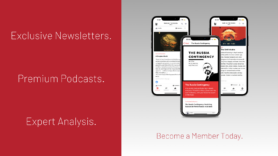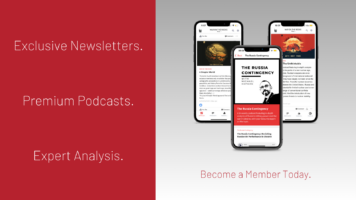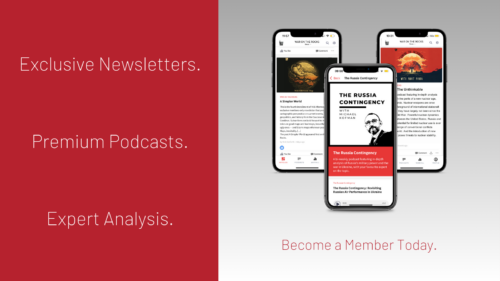Une image reste gravée dans les mémoires : un bulldozer conduit par des combattants de l’État islamique saccageant une digue de terre à la frontière entre l’Irak et la Syrie, les militants acclamant triomphalement au sommet de la machine. Ce moment ne représentait pas seulement une violation frontalière, mais un tir porté à l’histoire du Moyen-Orient moderne. Beaucoup d’analystes occidentaux voyaient alors la fin des États « artificiels », tandis que les groupes militants proclamaient la fin de l’histoire. Tous se trompaient. Aujourd’hui, cette digue est de retour, se tenant comme une revanche. Cette ligne n’a pas disparu ; elle s’est métamorphosée en un véritable canot de sauvetage régional. Ce que nous observons aujourd’hui est la revanche de l’État et le retour d’un processus indigène et sanglant de formation étatique.
Depuis le tournant du millénaire, la région a été considérée comme un laboratoire d’expérimentations majeures — de l’« agenda de la liberté » de l’administration George W. Bush aux espoirs suscités par le Printemps arabe. Pourtant, en regardant depuis les ruines de Gaza ou les lignes de front figées du Levant, il est simpliste de prétendre que le Moyen-Orient est plongé dans un chaos sans fin. En réalité, nous assistons à un brutal et organique processus de formation étatique. Tout comme l’Europe a dû traverser la dévastation de la guerre de Trente Ans pour comprendre la valeur de la souveraineté, le Moyen-Orient apprend sa propre leçon sur la souveraineté dans ce laboratoire sanglant des vingt-cinq dernières années, marqué par l’effondrement des rêves extérieurs imposés.
Un moment westphalien tardif, nous sommes témoins de l’effondrement d’un ordre extériorisé et de la naissance douloureuse d’un écosystème local réaliste. Dans cette nouvelle ère, la monnaie d’échange n’est plus idéologique ni fondée sur les valeurs du « ordre international libéral », mais sur la capacité brute et l’instinct de survie. Cette restauration n’est ni fluide, ni garantie. Elle s’appuie sur des cicatrices socio-économiques profondes et des alliances fragiles, mais elle existe indiscutablement. Pour les décideurs occidentaux, comprendre ce changement exige d’abandonner les schémas mentaux datant de 2003 ou 2011, et d’accepter une réalité frappante : l’époque de la reconstruction militaire et politique du Moyen-Orient est révolue. Place désormais à la gestion des survivants.
Acte I : L’arrogance et l’effondrement de l’État
Pour saisir la déchéance actuelle et la lutte pour la survie, il faut revenir au moment décisif où tout a basculé : l’invasion de l’Irak en 2003 n’a pas été un simple changement de régime. C’était la liquidation totale de l’autorité centrale et des capacités administratives au Levant et en Mésopotamie — le cœur géopolitique traditionnel du monde arabe — ainsi que l’atomisation du monopole de la violence.
La chute de la statue de Saddam Hussein ne symbolise pas uniquement la fin d’un dictateur. Elle marque l’effondrement des dirigeants personnifiant l’État selon la définition weberienne, et détenteurs du monopole de la violence. L’arrogance de Washington fut de croire que la construction étatique pouvait être un simple projet d’ingénierie. Cependant, cette débandade a déclenché des fractures sectaires et ethniques sous l’identité nationale, multipliant les sources de légitimité violente. Les populations privées de leur « Léviathan » — leur bouclier étatique protecteur — ont alors reconstruit leurs stratégies de survie autour d’identités ethniques et sectaires.
Cette invasion a aussi bouleversé le centre de gravité régional. Après la dissolution de l’Empire ottoman, le pouls du Moyen-Orient battait durant un siècle autour de Cairo, Damas et Bagdad. Avec l’écroulement ou le repli de ces centres traditionnels, le vide fut comblé par d’autres acteurs extérieurs à l’ordre arabe : Ankara, Téhéran et les monarchies pétrolières du Golfe.
Ce délabrement institutionnel a eu un impact dépassant largement l’Irak. Il a radicalement et brutalement transformé la nature de la politique régionale. La notion d’« opposition », présente depuis longtemps dans le monde arabe, a cédé la place à une guerre identitaire existentielle. La chute de Bagdad a libéré des forces armées transnationales, prêtes à remplir le vide violent, qui se sont transformées en mouvances régionales distinctes.
L’émergence de figures comme Abu Musab al Zarqawi affirma que la violence n’était plus un simple outil, mais une méthode de construction identitaire. Dans cette nouvelle configuration, où l’État perd son monopole sur la violence, chaque communauté s’est armée pour sa sécurité. La région a ainsi mis en place les bases logistiques et idéologiques des futurs grands conflits, notamment la guerre syrienne et la montée de Daech.
Acte II : L’illusion de la rue et le paradoxe des frontières
Si le premier acte fut marqué par l’arrogance américaine et la destruction institutionnelle, le deuxième fut celui de l’illusion populaire. La vague de 2011 s’étendant de la Tunisie au Caire n’était pas un acte d’ingérence, mais un cri authentique pour la dignité et un appel à un nouveau contrat social. Pourtant, ces soulèvements portaient en germe leur propre tragédie. La rue, chargée d’années de colère accumulée, avait la force de secouer voire abattre le régime de Moubarak, comme sur la place Tahrir.
Mais le drame venait du fait que la rue manquait d’architecture institutionnelle, de capacité organisationnelle et d’imagination politique pour remplacer les dictateurs par un ordre fonctionnel. L’échec des Frères musulmans à surmonter la résistance bureaucratique en Égypte ou l’incapacité des tribus libyennes à s’unir sous un État-nation a montré la fragilité de la victoire populaire.
Ce vide institutionnel a offert un terreau fertile aux acteurs non étatiques. Entre 2011 et 2018, la lutte principale n’a pas été étatique au sens classique, mais opposant un système étatique délégitimé à des acteurs revisionnistes cherchant à effacer cet ordre, comme l’État islamique proclamant un califat à l’est, les Kurdes en quête de cantonisation au nord, ou des milices fragmentées en Libye à l’ouest. Là où l’État reculait, des seigneurs de guerre ou des organisations comblaient le vide d’autorité.
C’est alors que le paradoxe le plus frappant de la région contemporaine se révèle : la résistante obstination des frontières « artificielles ». Les frontières issues des accords Sykes-Picot, longtemps rejetées comme un legs colonial, n’ont pas disparu, même au plus bas de la crise régionale. Malgré la désintégration des armées, la chute de grandes villes ou les sièges des capitales, ces lignes persistent. Pourquoi ?
Parce que dans un ordre défini par une lutte hobbesienne pour la survie, une frontière imparfaite assure plus de prévisibilité que l’abîme de l’anarchie. Par une expérience douloureuse, les populations ont appris que l’alternative à l’héritage ottoman ou au tracé colonial n’était ni une utopie panarabe, ni un califat pragmatique, mais une guerre généralisée, combattue à l’échelle des quartiers ou villages.
Durant cette période, les États et sociétés régionales se sont accrochés à ces frontières comme à des bouées de sauvetage. Le deuxième acte a vidé l’intérieur des États en Syrie, au Yémen, en Libye, transformant la souveraineté en fiction et le contrôle des frontières en chimère. Pourtant, ce « contenant » étatique — ses frontières et son existence juridique — a survécu. Quand Daech brûlait des passeports ou que le Parti de l’Union démocratique traçait ses propres cartes, il est apparu clairement que, quelles que soient les violences endurées, seule la structure étatique restait capable de fournir sécurité et subsistance.
Cependant, cette restauration est celle d’un « Léviathan blessé ». Le renouveau de l’appareil étatique n’a pas résolu les causes profondes des révoltes de 2011 : corruption, chômage des jeunes, inégalités. Ces enjeux restent hors de l’agenda public. Au contraire, de la crise monétaire au Caire à l’effondrement des infrastructures à Damas, la situation socio-économique semble pire qu’avant les révoltes. Ce qui a changé, c’est la hiérarchie des attentes sociales : l’expérience de l’absence d’État — avec les exécutions arbitraires, les pillages et la guerre — a réduit les aspirations à la survie et à la prévisibilité. La crainte d’un État tyrannique est désormais préférée au chaos total.
Pourtant, ce consentement reste un emplâtre temporaire plutôt qu’une base solide pour un ordre durable. Il ne s’agit pas d’un renouveau du contrat social mais d’un mécanisme de survie, susceptible de céder sous la pression d’une crise économique aggravée ou de chocs climatiques. La stabilité tient non à la légitimité, mais à l’absence d’alternatives. L’État tient encore la voûte, même si le sol se dérobe.
Acte III : Le retour à la lutte pour la survie
Au terme d’un quart de siècle de conflits et turbulences, une troisième phase s’ouvre au Moyen-Orient. Le tumulte s’est dissipé pour laisser place à un réalisme froid et dur. Les idéologies mobilisatrices du passé — panarabisme, panislamisme ou exportation de la démocratie libérale — ont perdu toute portée. Elles laissent place à un pragmatisme transactionnel.
C’est pourquoi, face aux protestations, l’Arabie saoudite a plaidé pour la continuité du régime iranien. Pourquoi également la Turquie et l’Égypte ont interrompu une décennie de froissement malgré des différends rhétoriques prononcés. Ces rapprochements ne résultent pas d’alignements idéologiques ou d’amitiés retrouvées, mais d’une logique d’épuisement et de reconnaissance mutuelle des rapports de forces. Un statu quo semblable à celui qui a conduit les puissances européennes à la paix de Westphalie.
Cependant, ce Westphalie régional naît dans un vide normatif. La guerre à Gaza après les attaques du 7 octobre a porté le coup de grâce à l’idée d’un « ordre international fondé sur des règles ». Pour les populations et élites régionales, l’incapacité ou le refus des puissances occidentales de faire respecter le droit international humanitaire a ruiné l’autorité normative occidentale. L’Occident n’est plus perçu comme bâtisseur d’ordre, au mieux comme partenaire d’intérêts, au pire comme fauteur de troubles.
Ce recul des normes ne se fait pas sans coûts pour les acteurs régionaux. Ce spectacle de violence déchaînée expose l’incapacité des États à protéger leurs populations. Ce décalage, entre la projection de puissance militaire et l’impuissance face aux carnages, menace de miner la légitimité intérieure reconquise âprement par ces régimes.
Cette impasse pousse à un autonomisme accru. Désormais, les capitales régionale agissent selon le principe qu’aucun secours extérieur ne viendra. Elles doivent conclure leurs propres alliances, développer leurs industries de défense, protéger leurs frontières.
Recherche d’un concert régional : des blocs externes à l’équilibre interne
La restauration de l’État-nation et de l’équilibre des puissances ont non seulement laissé à l’Europe la souveraineté, mais aussi un système souple d’alliances évitant la domination d’un seul hégémon — un équilibre qui a permis à l’Europe de rester un ordre régional stable pendant des siècles. Le Moyen-Orient vit aujourd’hui précisément la construction tardive de ce mécanisme.
Durant la Guerre froide et après, les alliances dans la région avaient peu de vie organique. Dominées par la rivalité globale entre Washington et Moscou, elles furent importées, de l’Alliance de Bagdad aux coalitions contre-terroristes. Aujourd’hui, le retrait américain et l’engagement russe enlisés poussent la région à élaborer des alliances et équilibres intérieurs.
Le tableau qui émerge peut paraître complexe mais repose sur une logique cohérente. D’un côté, la ligne Israël-Émirats Arabes Unis, fondée sur la coopération sécuritaire et technologique, forme un bloc de statu quo au-delà des Accords Abraham. De l’autre, l’équation Turquie-Arabie saoudite, intensifiée par des rapprochements récents et une coopération industrielle militaire (notamment en matière de drones), réincarne l’axe traditionnel du pouvoir régional. Ce pilier repose sur la doctrine militaire turque et une industrie de défense robuste, éprouvée en Libye, Syrie et dans le conflit du Haut-Karabakh. Ankara ne vient pas faire de la figuration mais est un fournisseur effectif de puissance concrète capable de combler des lacunes sécuritaires.
Ces lignes ne forment pas des blocs rigides à la manière de la Guerre froide. Elles sont des nœuds de pouvoir flexibles, ouverts aux échanges lorsque les intérêts convergent. L’intensité des relations économiques Turquie-Émirats ou la diplomatie informelle entre Arabie saoudite et Israël attestent que cette architecture est un jeu d’équilibre multi-couche, fluctuant selon les contextes.
Autre différence majeure avec les alliances d’autrefois, cette nouvelle structure est indigène. Dans les années 1950 ou 1990, s’allier signifiait renoncer à la souveraineté contre la protection des superpuissances. Aujourd’hui, les rapprochements sont modelés par la nécessité d’autonomie imposée par le vide sécuritaire et les menaces régionales, et non par des incitations extérieures.
Il serait naïf de voir ce nouvel ordre comme un projet de paix durable. Les rapprochements actuels ne sont pas fondés sur des affinités ou l’oubli des rivalités historiques, mais sur des alliances froides nées de peurs partagées. Ces acteurs se réunissent par nécessité, formant un équilibre aussi précaire que celui de l’Europe du XIXe siècle. Si les perceptions de menace évoluent ou si les pressions internes faiblissent, ces réseaux peuvent rapidement redevenir compétitifs. Paradoxalement, l’histoire régionale montre que cette méfiance mutuelle est ce qui garantit le plus la stabilité.
Ce n’est pas une rupture, mais un processus prometteur de stabilité, sinon de paix définitive. Les alliances imposées de l’extérieur s’effondrent du jour au lendemain quand le soutien disparaît. Celles construites sur des dynamiques internes et des équilibres d’intérêts (défense, énergie, commerce) constituent un système immunitaire pour l’ordre régional. Ces alignements n’éteignent pas les rivalités ni ne mettent fin aux conflits à court terme, mais ils limitent l’escalade et maintiennent la compétition en dessous du seuil de guerre totale. L’équilibre naissant est donc une structure résiliente, capable d’absorber conflits chroniques et chocs soudains sans imploser.
Le Moyen-Orient, à l’image de l’Europe du XIXe siècle, prend conscience que prévenir la guerre passe par l’établissement d’un concert régional et d’un équilibre des puissances, qui ne peut venir que d’alliances internes. Les alignements actuels ne traduisent donc pas une polarisation, mais la recherche d’un centre de gravité propre.
Reste la question cruciale : quelle durabilité pour un système fondé uniquement sur l’équilibre des puissances, sans assise normative ? Les ruines de Gaza ont profondément ébranlé l’idée d’une société internationale moderne fondée sur des normes occidentales universelles dans la région. Mais cela ne signifie pas un vide normatif total. C’est au contraire un combat entre le déclin de normes importées et l’émergence de modèles normatifs locaux, divergents et concurrents : la vision turque des années 2000 de « zéro problème » et intégration commerciale, la solidarité chiite iranienne construite autour de l’axe de la résistance, la diplomatie basée sur la foi du Qatar, ou l’affirmation stratégique de l’axe Émirats Arabes Unis-Arabie Saoudite.
Il faut éviter le piège téléologique qui consisterait à croire que ce combat mènera inévitablement à un consensus comparable à la paix de Westphalie. Tandis que cette dernière a scellé le principe de cuius regio, eius religio après trente ans de guerre, le Moyen-Orient pourrait ne jamais aboutir à un unique accord normatif. Plutôt que vers un ordre unifié, nous assistons peut-être à une fragmentation normative permanente, où ces visions rivales cohabitent dans une friction constante. Tant qu’un ensemble partagé de règles ne sera pas défini, ce nouvel ordre restera fragmenté, volatile et exposé aux accidents. L’État est revenu, certes, mais il n’a pas encore trouvé son esprit ni sa loi.
Gérer des survivants
Quelles implications pour les États-Unis et leurs alliés ? Le temps des leçons est fini. Le Moyen-Orient possède désormais sa propre agentivité, ses propres traumatismes, et une logique froide qui lui est propre.
Premièrement, il faut accepter que le levier normatif est brisé. L’influence future reposera non plus sur la morale, mais sur des relations transactionnelles fondées sur les intérêts, le commerce et la coopération sécuritaire.
Deuxièmement, il faut cesser de chercher les modérés des années 2000 ou les révolutionnaires de 2011. Ils ont disparu. L’avenir appartient aux survivants, aux États forts. Si la stabilité doit émerger, ce sera à partir d’États solides capables de monopoliser la violence sur leur territoire, pas à partir de gouvernements faibles soutenus uniquement par l’aide étrangère.
Enfin, il faut engager des puissances comme la Turquie non pas comme des partenaires indisciplinés à réintégrer, mais comme des architectes indépendants de ce nouvel ordre. Les frontières « artificielles » du Moyen-Orient ont prouvé leur solidité face aux tentatives les plus ambitieuses de les redessiner. La région est marquée, cynique et surarmée. Mais pour la première fois en un siècle, elle trace son propre chemin.
Le choix pour l’Occident est clair : soit s’asseoir à la table avec ceux qui dessinent cette nouvelle carte dure, soit rester simple spectateur sur la touche, attendant que l’ordre se constitue.
Ali Murat Kursun est maître de conférences en relations internationales à l’université Marmara en Turquie. Docteur obtenu à l’université d’Aberystwyth, il se concentre sur l’ordre régional au Moyen-Orient. Ses travaux ont été publiés dans International Politics, Third World Quarterly et All Azimuth, entre autres. Il est membre de l’Association des chercheurs sur le Moyen-Orient et l’Afrique à Istanbul.