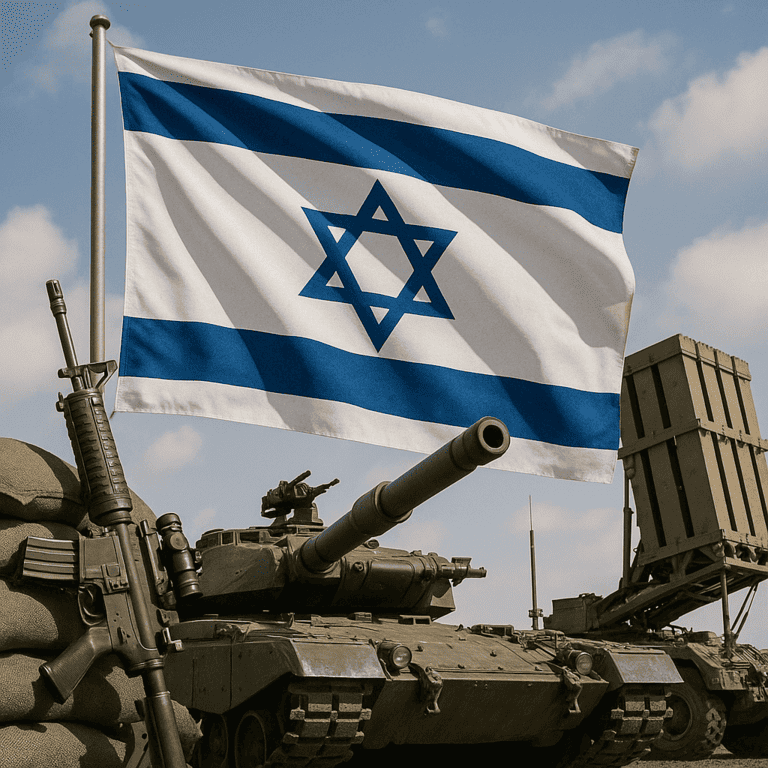Début janvier 2026, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a provoqué une onde de choc. Dans une interview accordée à The Economist, il a évoqué son souhait de « réduire progressivement » les 3,8 milliards de dollars d’aide militaire annuelle que les États-Unis versent à Israël, voire d’y mettre fin totalement. Pourtant, Netanyahu affirme dans le même entretien qu’Israël est engagé dans une lutte pour défendre « toute la civilisation occidentale » face à des « forces fanatiques » cherchant à « nous ramener au début du Moyen Âge ». Cette prise de position est d’autant plus surprenante que des rapports antérieurs laissaient entendre que Netanyahu souhaitait non seulement renouveler cet accord d’aide militaire, mais aussi doubler sa durée. Pourquoi, alors, vouloir couper cette aide unique en son genre?
La clé de compréhension réside dans ce que Netanyahu n’a pas dit. Il n’a pas remis en cause la politique américaine historique visant à préserver la supériorité militaire qualitative d’Israël au Moyen-Orient, qui engage les États-Unis à garantir que l’armée israélienne dispose d’une avance technologique décisive face à tout autre acteur régional, qu’il soit allié ou ennemi.
Face aux bouleversements récents dans la région et au retour de flamme subi par Washington, une réévaluation sobre de cet engagement et de l’aide militaire américaine paraît pertinente. Cependant, la position implicite de Netanyahu — mettre fin au soutien américain tout en maintenant cette supériorité qualitative — serait la pire des options. Réduire l’intervention américaine dans la prise de décision israélienne supprimerait les rares contraintes existantes sur le virage stratégique révisionniste de Jérusalem. Mettre fin à toute aide militaire comme le propose Netanyahu est irréaliste, mais rendre cette aide plus conditionnelle pourrait rééquilibrer la relation en faveur de Washington. Ce ne serait pas un droit de veto absolu, mais cela mettrait fin à une dépendance coûteuse et sans contrepartie, qui ne sert les intérêts d’aucune des deux parties. Par ailleurs, perpétuer l’engagement de la supériorité militaire limite la capacité des États-Unis à renforcer leurs liens avec d’autres partenaires régionaux non israéliens, ouvrant la porte à l’influence de puissances rivales comme la Russie ou la Chine.
L’évolution de l’aide militaire américaine à Israël
L’aide militaire américaine à Israël suscite inévitablement la controverse, en partie parce que tout ce qui touche au conflit arabo-israélien est toujours sensible, et en partie à cause des montants colossaux en jeu. Le Council on Foreign Relations estime que l’aide militaire totale versée à Israël depuis 1946 avoisine les 244 milliards de dollars, loin devant l’Afghanistan qui arrive deuxième avec 133 milliards. Actuellement, les États-Unis allouent à Israël 3,3 milliards de dollars par an sous forme de financement militaire étranger, auxquels s’ajoutent 500 millions dédiés à la défense antimissile. En pratique, ce montant est un minimum : pour l’année fiscale 2024-2025, l’aide américaine a atteint près de 18 milliards.
Au fil des décennies, la promesse de garantir la supériorité qualitative d’Israël s’est transformée d’un engagement politique en une obligation formelle. Cela découle de divergences répétées entre administrations américaines et israéliennes sur la portée exacte de cet engagement : quels niveaux et types de technologie militaire doivent être fournis ? Quelles ventes d’armes sont autorisées à destination d’autres pays de la région ?
C’est pourquoi la promesse de vendre aux Saoudiens des chasseurs F-35 « dernier cri » — plutôt que des versions limitées — par l’administration Trump en novembre 2025 a suscité de vives contestations, notamment parmi les alliés d’Israël au Congrès américain, et ce même si Netanyahu semblait favorable à la fin de l’aide militaire américaine.
Par ailleurs, une loi de 2008 impose que toute vente d’armes dans la région, autre qu’à Israël, soit précédée d’une certification adressée au Congrès garantissant que cette transaction ne compromettra pas la supériorité qualitative israélienne. En pratique, cette règle est davantage politique que légale, les administrations américaines usant de certifications créatives et de compensations pour contourner les obstacles, ce qui complique le processus sans bloquer systématiquement les ventes d’armes.
Un exemple historique illustre ces tensions : au début des années 1980, après l’annonce par l’administration Reagan de la vente d’avions de détection précoce AWACS à l’Arabie saoudite, Washington a dû mobiliser un important capital politique pour passer outre les objections du lobby pro-israélien et de nombreux élus. La vente fut finalement validée, mais seulement après qu’un important paquet d’armement ait été accordé à Israël en compensation. L’incident a néanmoins terni l’image de l’Arabie saoudite aux États-Unis, poussant Riyad à se tourner ensuite vers le Royaume-Uni pour ses principaux contrats d’armement.
Deux principes interdépendants sous-tendent la dimension militaire de la relation spéciale américano-israélienne : d’une part, le financement américain des acquisitions militaires israéliennes ; d’autre part, la garantie d’un équilibre militaire régional assurant la supériorité d’Israël face à tout adversaire. C’est ce second principe, la supériorité militaire qualitative, qui conditionne le premier, car il autorise et justifie le niveau de financement ainsi que l’accès israélien à des technologies de pointe inaccessibles aux voisins.
La logique stratégique de la supériorité militaire qualitative d’Israël
Si l’aide américaine à Israël était modeste dans les années 1950-1960, la rivalité Est-Ouest a progressivement rapproché Jérusalem et Washington. En 1962, Kennedy vendait des missiles anti-aériens Hawk à Israël pour contrer les bombardiers soviétiques en Egypte. Le véritable tournant survient avec la guerre des Six-Jours de 1967 : les États-Unis considèrent alors l’Egypte et la Syrie comme des alliés soviétiques agressifs, qui subissent une défaite écrasante. Un an plus tard, Washington équipe Israël de F-4 Phantom, la première livraison de technologie militaire avancée détenue exclusivement par Israël dans la région.
Cette relation spéciale se confirme et se structure après la guerre du Kippour en 1973. Alors qu’Israël est attaqué par surprise, ses alliés européens refusent de le soutenir par crainte d’un embargo pétrolier arabe, tandis que les États-Unis procèdent à un réapprovisionnement militaire massif de 2,2 milliards de dollars sous Nixon. Le conseiller à la sécurité nationale Henry Kissinger explique alors aux Saoudiens : « Les Israéliens savent maintenant à quel point ils dépendent des États-Unis, cela signifie qu’ils vont nous écouter. » Washington pousse Israël à faire des concessions après le cessez-le-feu, tout en renforçant son assistance militaire, selon le principe de « matériel contre concessions » : fournir une technologie de pointe et un soutien accru devait sécuriser Israël et le rendre plus enclin à prendre des risques calculés pour la paix.
Ce paradigme s’est révélé payant : en 1974, Israël concède du territoire hors conflit armé en restituant une partie du Sinaï à l’Egypte. En échange de concessions politiques égyptiennes, Israël obtient une garantie américaine d’élargir le soutien militaire à long terme. En 1975, Israël reçoit 8,3 milliards de dollars d’aide militaire en une seule année financière et Washington s’engage officiellement à préserver sa supériorité qualitative.
Depuis, l’aide militaire américaine n’est jamais descendue en dessous de 3 milliards de dollars par an, et les accords bilatéraux formalisés incitent Israël à maintenir au mieux ses intérêts stratégiques dans une région en mutation, passant de la menace soviétique à la menace iranienne.
La situation actuelle de la garantie de supériorité qualitative
Les critiques de cette relation spéciale dénoncent souvent l’influence du lobby pro-israélien sur la stratégie américaine, évoquant une aide militaire sans conditions sérieuses. Si certains défendent cette alliance au nom de valeurs partagées comme la démocratie libérale et des objectifs communs tels que la containment de l’Iran, ce glissement a diminué la marge de manœuvre américaine sur la politique israélienne. Le Congrès américain intervient désormais davantage lorsque les décisions de l’exécutif sont perçues comme contraires aux intérêts d’Israël.
Cette perte d’influence ne s’explique pas uniquement par les actions israéliennes ou l’évolution du pouvoir régional, mais résulte aussi de contraintes internes au système politique américain, plus fortes aujourd’hui qu’à l’époque où ce paradigme s’est mis en place. Les pressions des groupes de lobbying, les financements de campagne et la crainte des électeurs rendent l’aide difficile à remettre en cause. Netanyahu lui-même a appris à utiliser ce contexte pour augmenter les coûts politiques de toute critique publique.
En dépit de cette dynamique, l’aide américaine a indéniablement permis à Israël de posséder une supériorité militaire clé dans la région, contribuant à neutraliser plusieurs menaces partagées. Depuis les attaques de Hamas le 7 octobre 2025, Israël a intensifié ses actions militaires, avec des résultats marquants : affaiblissement du Hezbollah, quasi-disparition du régime syrien et ralentissement du programme nucléaire iranien. Le développement conjoint des systèmes de défense antimissile est emblématique de cette collaboration militaire.
Cependant, le volet « logiciel » de cette relation, c’est-à-dire la capacité de l’aide américaine à encourager des compromis politiques, semble défaillant. Malgré l’apogée de la puissance militaire israélienne et l’affaiblissement de ses ennemis, Israël a étendu son contrôle territorial à Gaza, en Cisjordanie, au Liban et en Syrie. Depuis octobre 2025, bien que l’aide militaire ait augmenté, Israël ne montre aucun signe d’ouverture pour des concessions, ce qui illustre le décalage entre l’assistance fournie et les attentes politiques américaines.
Cette situation est accentuée par la dérive stratégique israélienne vers une hégémonie régionale fondée sur la force, ce qui oblige à repenser les paradigmes en place. Ironicement, Netanyahu souhaite une réévaluation précisément pour réduire l’influence américaine sur la politique israélienne — un leitmotiv déjà présent dans ses premières années au pouvoir dans les années 1990.
Vers un nouveau paradigme
Netanyahu bluffe probablement, tant la coopération américano-israélienne est enracinée pour que toute fin complète de l’aide avant 2028 soit envisageable. Il est cependant conscient des tensions inédites qui traversent ce partenariat : l’opinion américaine est de plus en plus réticente à maintenir les niveaux actuels d’aide militaire. Certains analystes s’interrogent même pour savoir si Joe Biden sera « le dernier président démocrate pro-Israël » capable de concilier affinities idéologiques et contraintes politiques intérieures.
Mais garantir la supériorité militaire tout en réduisant l’aide ne convaincrait ni les électeurs américains ni les alliés régionaux inquiets de la politique israélienne actuelle. Cette double posture condamnerait les États-Unis à soutenir implicitement les actions israéliennes sans pouvoir réellement les influencer.
La solution réside plutôt dans un nouveau mémorandum d’entente encadrant plus strictement l’aide militaire, conditionnée à la volonté israélienne de compromis, avec une révision tous les cinq ans — comme c’était le cas au début — au lieu de dix actuellement. Cela permettrait une adaptation plus fréquente, avec des montants pouvant augmenter ou diminuer en fonction des contextes, maximisant ainsi le « retour sur investissement » américain. Ce système reposerait sur un modèle transactionnel, cher à l’approche souhaitée par l’administration Trump vis-à-vis de ses alliés occidentaux.
Cette évolution ne donnerait pas un contrôle absolu à Washington, ce qui serait ni souhaitable ni réaliste. Elle réintroduirait simplement des points d’influence réguliers dans un système devenu permissif, permettant d’orienter sans contraindre durement la politique israélienne. Il convient de nuancer l’espoir parfois exagéré que les États-Unis puissent dicter leur loi à Israël. La réalité est que les contraintes institutionnelles et les coûts politiques sont désormais plus élevés que jamais pour toute administration américaine.
Parallèlement, il est nécessaire de repenser la garantie de supériorité qualitative, une politique héritée du passé qui ne correspond plus pleinement aux réalités actuelles. Israël n’est plus le seul allié majeur des États-Unis dans la région. D’autres partenaires non membres de l’OTAN comme l’Égypte, le Maroc ou Bahreïn entretiennent des relations diplomatiques pleines avec Israël. Certains, tels que l’Arabie saoudite ou le Qatar, envisagent même une normalisation en lien avec un éventuel État palestinien.
Cette garantie militaire limite aussi la capacité américaine à vendre des armes à d’autres pays partenaires, freinant le renforcement des alliances locales. Ce blocage profite paradoxalement à des acteurs comme la Russie et la Chine, vers lesquels certains États se tournent désormais faute d’offres américaines adaptées. Ce phénomène a notamment affecté l’achat de F-35 par les Émirats arabes unis, finalement remplacé par des achats auprès de la France et de la Chine.
Les défenseurs d’Israël craignent un risque d’escalade ou la mise en danger de l’unique démocratie du Moyen-Orient. Mais ils oublient que cette politique a souvent exacerbé la prolifération régionale, obligeant Washington à fournir à Israël encore plus d’armes avancées pour compenser les ventes arabes. Le cas du radar AWACS saoudien prouve que l’engagement américain n’a pas arrêté les ventes, seulement alourdi les coûts politiques et les risques de rejet.
Il est important de souligner que le risque pour la sécurité d’Israël est aujourd’hui sans doute plus faible, grâce à une puissance militaire désormais dominante dans la région, rendue possible par l’aide américaine. Par ailleurs, la récente stratégie de sécurité nationale américaine indique que les préoccupations normatives — telles que les valeurs démocratiques — pèseront moins dans la conduite de la politique américaine.
Face à l’opinion publique américaine, aux déclarations publiques de Netanyahu et aux pressions régionales, la dynamique de changement est actée. La véritable interrogation est maintenant de savoir si les États-Unis sauront piloter cette transition pour servir leurs intérêts, consolider la sécurité israélienne et instaurer une stabilité durable au Moyen-Orient.
Rob Geist Pinfold est chargé de cours en sécurité internationale au département des études de défense du King’s College London, chercheur associé au Centre de recherche sur la paix de l’Université Charles à Prague, et professeur adjoint à la Johns Hopkins School of Advanced International Studies à Bologne.